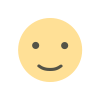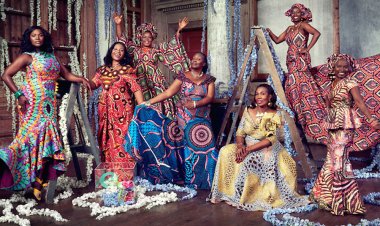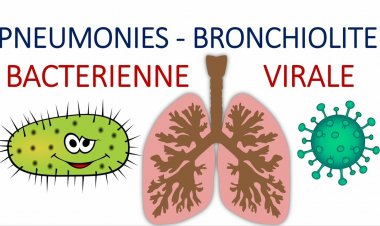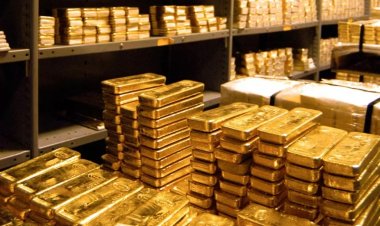La plus grande crise humanitaire du monde dont personne ne parle
Un enfant meurt toutes les deux heures au camp de Zamzam. 12 millions de Soudanais ont fui leurs maisons. 25 millions ne mangent pas à leur faim. La plus grande catastrophe humanitaire jamais enregistrée se déroule en temps réel, documentée, chiffrée, pendant que les médias occidentaux la couvrent 166 fois moins que l'Ukraine ou Gaza. Ce silence n'est pas un accident. C'est un choix qui révèle la hiérarchie inavouée de notre compassion.

Un enfant meurt toutes les deux heures au camp de Zamzam. Pendant que vous lisez ces lignes, trois autres sont morts. Ils ne mourront pas d'une balle perdue. Ils mourront de faim, lentement, dans l'indifférence quasi-totale de la communauté internationale.
Le Soudan vit la plus grande catastrophe humanitaire jamais enregistrée. Pas "une des plus grandes". La plus grande. 12 millions de personnes déplacées. 25 millions en insécurité alimentaire aiguë. 637 000 personnes dans des conditions de famine catastrophique. Des chiffres qui dépassent Gaza. Qui dépassent l'Ukraine. Et pourtant, vous n'en avez probablement jamais entendu parler.
LE MASSACRE DOCUMENTÉ
Commençons par ce que nous savons. Plus de 60 000 morts depuis avril 2023. Mais ce chiffre, déjà vertigineux, masque une réalité plus brutale encore. À Zamzam, dans le Darfour Nord, 400 000 personnes sont coincées dans un camp où règne la famine. Les médecins de MSF rapportent qu'un enfant meurt toutes les deux heures. Faites le calcul: 12 enfants par jour. 360 par mois. Dans un seul camp.
La malnutrition aiguë touche un tiers des enfants soudanais. Un tiers. Pour référence, le seuil international qui confirme une famine est de 20%. Le Soudan le dépasse de 50%. Dix zones sont officiellement en état de famine. La moitié de la population, 25 millions de personnes, ne sait pas d'où viendra son prochain repas.
80% des hôpitaux dans les zones de conflit ne fonctionnent plus. 119 attaques documentées contre des établissements de santé en 18 mois. Quand vous êtes blessé au Soudan, vous n'avez nulle part où aller. Quand vous êtes malade, vous mourez chez vous. 90% des écoles sont fermées. Une génération entière grandit sans éducation, sans soins, sans avenir.
Voici ce que signifie "la plus grande crise humanitaire jamais enregistrée": c'est un pays entier qui s'effondre en temps réel, documenté par les agences internationales, pendant que le monde regarde ailleurs.
LE SILENCE ORGANISÉ
Les chiffres de la couverture médiatique sont obscènes. En 2024, le Soudan a généré 600 articles mensuels dans les médias occidentaux. Gaza et l'Ukraine? Plus de 100 000 chacun. Un ratio de 1 pour 166.
Ce n'est pas un accident. C'est un choix.
Premier mécanisme: la hiérarchie géopolitique. François Sennesael, chercheur à Oxford, le dit sans détour: "Le conflit au Soudan n'est pas aussi géopolitiquement important que l'Ukraine ou Gaza pour l'Occident." Traduction: les Soudanais ne comptent pas. L'Ukraine menace la sécurité européenne. Gaza active des clivages politiques profonds en Occident. Le Soudan? C'est l'Afrique. Une crise de plus dans un continent qu'on a appris à ignorer.
Deuxième mécanisme: l'impossibilité de couvrir. Plus de 400 journalistes soudanais ont fui le pays. Les deux factions militaires, les Forces armées soudanaises et les Rapid Support Forces, ont systématiquement ciblé les médias. Plus de 40 organes de presse fermés. 75 ans d'archives médiatiques détruits. Les journalistes encore sur place risquent l'enlèvement, la torture, la mort. Les étrangers se voient refuser l'entrée.
Sans images, pas d'histoire. Sans journalistes sur le terrain, pas de récit qui accroche. Les rédactions occidentales préfèrent envoyer leur dixième correspondant à Kiev plutôt qu'un premier à Khartoum. C'est plus sûr. Plus rentable. Plus "pertinent" pour leur audience.
Troisième mécanisme: la complexité narrative. L'Ukraine, c'est simple: un agresseur clair (la Russie), une victime (l'Ukraine). Gaza active des lignes de fracture politiques anciennes. Le Soudan? Deux factions militaires rivales, des intérêts régionaux opaques, des alliances changeantes. Trop compliqué pour un article de 800 mots. Trop nuancé pour générer de l'indignation virale sur les réseaux sociaux.
Résultat: le plan de réponse humanitaire de 4,2 milliards de dollars pour 2025 n'est financé qu'à 25%. Les organisations sur place rationalisent l'aide. Elles choisissent qui manger et qui mourra de faim. Pendant ce temps, l'aide à l'Ukraine et à Gaza continue d'affluer. Pas parce que ces crises sont moins légitimes, mais parce qu'elles sont visibles.
LA QUESTION QUI DÉRANGE
Voilà ce que le Soudan révèle: notre compassion est hiérarchisée. Elle suit des lignes géopolitiques, des calculs d'intérêt national, des proximités culturelles inavouées.
Nous avons appris à vivre avec cette équation: une vie européenne vaut plus qu'une vie africaine. Un mort à Kiev génère plus d'émotion qu'un mort à Khartoum. Ce n'est pas que nous soyons consciemment racistes. C'est pire: nous avons intégré cette hiérarchie au point qu'elle nous semble naturelle.
Le test du Soudan, c'est celui-ci: sommes-nous capables de nous indigner pour des gens dont la mort ne nous affecte pas directement? Pouvons-nous mobiliser pour une crise qui ne menace ni notre sécurité, ni nos intérêts économiques, ni notre confort moral?
La réponse, jusqu'ici, est non.
Certains diront: on ne peut pas s'occuper de toutes les crises du monde. Vrai. Mais le Soudan n'est pas "une crise parmi d'autres". C'est la plus grande. Et nous avons choisi de l'ignorer non pas faute de moyens, mais faute d'intérêt.
D'autres invoqueront la "fatigue compassionnelle". Comme si l'empathie était une ressource limitée qu'il faut rationner. Mais on ne rationne pas l'attention médiatique sur l'Ukraine. On ne rationne pas l'aide à Israël. La fatigue est sélective.
Le Soudan nous tend un miroir. Ce que nous y voyons est inconfortable: une communauté internationale qui parle de droits humains universels mais pratique une géométrie variable de la dignité. Des médias qui prétendent informer mais reproduisent les angles morts de leurs audiences. Des citoyens qui s'indignent sur commande, selon que la victime ressemble ou non à ce qu'ils connaissent.
12 millions de déplacés. Un enfant mort toutes les deux heures. La plus grande crise humanitaire jamais enregistrée.
Et notre silence assourdissant.


 moulaye
moulaye