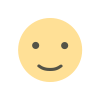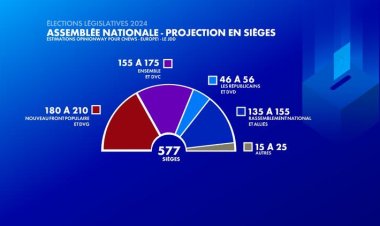Tanzanie : Les 700 morts fantômes d'une élection à 97%
Le 29 octobre 2025, la présidente Samia Suluhu Hassan remporte l'élection présidentielle tanzanienne avec 97,66?s voix. Trois jours plus tard, l'opposition affirme que 700 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations. Entre ces deux chiffres vertigineux se cache une catastrophe démocratique dont personne ne parle.

I. Une nuit de violence dans la capitale économique
Le mercredi 29 octobre 2025, vers 21 heures, alors que les premiers résultats du dépouillement commencent à circuler à Dar es-Salaam, des centaines de jeunes hommes descendent dans les rues de Kariakoo, le quartier commerçant populaire de la capitale économique tanzanienne. Ils scandent "Rudisha nchi yetu!" - "Rendez-nous notre pays!". Certains portent des t-shirts verts, la couleur du Chadema, le principal parti d'opposition. D'autres n'ont aucun signe distinctif politique, juste la rage au visage.
En quelques heures, la situation bascule. Des commissariats sont incendiés. Des bâtiments officiels brûlent. Les bannières géantes à l'effigie de la présidente Samia Suluhu Hassan, installées depuis des semaines sur les grandes artères, sont arrachées et piétinées. La police riposte avec des gaz lacrymogènes, puis avec des armes à feu. Des chars de combat prennent position aux principaux carrefours de la ville. Un couvre-feu est décrété dans la nuit.
Le lendemain matin, Internet ne fonctionne plus. Les écoles reçoivent l'ordre de fermer. Les fonctionnaires doivent travailler depuis chez eux. La Tanzanie, pays de 68 millions d'habitants, vient de basculer dans le noir informationnel.
Samedi 1er novembre, la Commission électorale proclame les résultats officiels : Samia Suluhu Hassan est réélue avec 97,66% des voix, soit 31,9 millions de votes sur 32,7 millions de suffrages exprimés. Son investiture a lieu le jour même, dans une cérémonie accélérée diffusée à la télévision d'État. Dans les rues de Dar es-Salaam, les chars sont toujours là.
Entre ces deux moments - l'explosion de violence du mercredi soir et la victoire triomphale du samedi - se trouve un angle mort que personne ne peut mesurer avec certitude. Combien de personnes sont mortes? Cent? Cinq cents? Sept cents? La vérité est devenue la première victime de cette élection.
II. L'ampleur d'une catastrophe contestée
Le brouillard des chiffres
Vendredi 31 octobre, le Chadema publie un communiqué depuis son quartier général de Dar es-Salaam, partiellement investi par la police. Le parti affirme qu'"environ 700 personnes" ont été tuées lors des manifestations post-électorales. Une source au sein des forces de sécurité, interrogée anonymement par l'Agence France-Presse, confirme un bilan similaire.
Le même jour, Amnesty International publie un rapport urgent. L'organisation évoque "au moins 100 morts", reconnaissant que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé mais qu'elle ne peut le vérifier dans le contexte de coupure des communications. Une source diplomatique occidentale, citée par plusieurs médias internationaux, fait état de "preuves crédibles d'au moins 500 décès".
Le gouvernement tanzanien rejette ces bilans comme "très exagérés" et "propagande de l'opposition". Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Thabit Kombo, déclare sur Al-Jazeera : "Je n'ai pas vu ces 700 morts. Nous n'avons encore aucun chiffre pour aucune victime". Il parle de "poches de violence" localisées et nie tout usage excessif de la force par les forces de l'ordre.
Cette guerre des chiffres illustre le chaos informationnel créé par la coupure d'Internet. Sans possibilité de filmer, de communiquer, de documenter en temps réel, la vérité devient malléable. Les hôpitaux de Dar es-Salaam sont sous surveillance policière. Les morgues ne communiquent aucun bilan. Les journalistes locaux qui tentent de couvrir les événements sont arrêtés ou menacés.
Une jeunesse au bord de l'explosion
Ces violences ne surgissent pas du néant. Elles reflètent une frustration accumulée dans un pays où 44% de la population a moins de 15 ans et où plus de 60% sont des enfants et jeunes de moins de 18 ans. La Tanzanie possède l'une des populations les plus jeunes d'Afrique, et cette jeunesse suffoque.
Le chômage des jeunes atteint des niveaux catastrophiques dans les zones urbaines, particulièrement à Dar es-Salaam. Près de 50% de la population tanzanienne vit avec moins de 1,9 dollar par jour, selon les dernières données de la Banque mondiale. Pour ces millions de jeunes Tanzaniens sans emploi, sans perspective, la promesse démocratique d'une alternance politique représentait le dernier espoir de changement.
Quand cet espoir s'est évaporé le 29 octobre, la violence a explosé.
La répression, méthode de gouvernement
Les manifestations de fin octobre ne sont pas un incident isolé. Elles s'inscrivent dans un cycle de répression qui s'est intensifié depuis 2024. Amnesty International, dans plusieurs rapports publiés entre 2024 et 2025, documente une "vague de terreur" marquée par :
- Des arrestations massives d'opposants et d'activistes
- Des intimidations systématiques contre les défenseurs des droits humains
- Des restrictions croissantes sur les médias et les réseaux sociaux
- Des disparitions forcées
- Des exécutions extrajudiciaires
Cette répression s'est accélérée à mesure que l'élection approchait. En avril 2025, Tundu Lissu, chef du Chadema et principal rival de Samia Hassan, a été arrêté et inculpé pour trahison - une accusation passible de la peine capitale en Tanzanie. Son arrestation a entraîné l'exclusion automatique de sa candidature.
Quelques semaines plus tard, Luhaga Mpina, candidat du ACT-Wazalendo (le seul autre parti d'opposition significatif), a été disqualifié pour des "irrégularités internes" jamais clairement expliquées par la Commission électorale.
Ces deux éliminations ont transformé l'élection présidentielle en exercice de légitimité plutôt qu'en compétition politique réelle. Samia Hassan a affronté 16 autres candidats, tous issus de petits partis marginaux sans influence. Le Chama Cha Mapinduzi (CCM), le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1961, a dominé sans rival crédible.
III. Les acteurs d'un verrouillage démocratique
Samia Hassan : de l'espoir à la répression
Lorsque Samia Suluhu Hassan arrive au pouvoir en mars 2021, après le décès subit du président John Magufuli, beaucoup d'observateurs y voient une opportunité de renouveau. Première femme à la tête de la Tanzanie, originaire de Zanzibar, elle incarne une rupture symbolique forte.
Ses premiers discours sont prometteurs. Elle promet de "protéger la Constitution" et d'assurer "la justice sans crainte, ni faveur, ni haine". Elle lève l'interdiction des rassemblements politiques de l'opposition, imposée depuis 2016. Elle adopte une rhétorique d'ouverture et de dialogue qui contraste avec l'autoritarisme brutal de Magufuli.
Mais ce printemps libéral dure moins de trois ans. À partir de 2024, le régime Hassan resserre progressivement son étau. Les ONG documentent un retour aux méthodes Magufuli : arrestations arbitraires, harcèlement judiciaire des opposants, contrôle des médias, manipulation électorale.
Ce qui distingue Hassan de son prédécesseur n'est pas la nature de la répression, mais son style. Là où Magufuli était brutal et direct, Hassan maintient un vernis de respectabilité internationale. Elle parle de "réconciliation" et de "dialogue" tout en éliminant méthodiquement toute opposition crédible. Son programme annoncé pour le second mandat comprend des promesses de "réconciliation, réforme, reconstruction et résilience" ainsi qu'un processus constitutionnel à lancer dans les 100 jours - des engagements qui sonnent creux après les violences de fin octobre.
Le CCM : une machine à perpétuité
Derrière Samia Hassan se trouve le véritable centre du pouvoir tanzanien : le Chama Cha Mapinduzi. Ce parti gouverne la Tanzanie depuis l'indépendance en 1961, soit 64 ans de monopole politique quasi-ininterrompu.
Le CCM n'est pas seulement un parti politique. C'est un appareil d'État, une structure économique, un réseau social qui contrôle l'administration, l'armée, la justice, les médias publics, une large partie de l'économie. Ce système de contrôle total rend toute alternance politique presque impossible sans une implosion du régime lui-même.
La Commission électorale, dirigée par Jacobs Mwambegele, fonctionne comme un rouage de cette machine. C'est elle qui a disqualifié Luhaga Mpina. C'est elle qui a validé l'inculpation de Tundu Lissu comme motif d'exclusion. C'est elle qui a proclamé des résultats de 97,66% sans sourciller, dans un pays où l'opposition est massivement réprimée et où le scrutin a été boycotté par une grande partie de la population.
Zanzibar : une contestation dans la contestation
La situation à Zanzibar ajoute une couche de complexité. Cet archipel semi-autonome, dont Samia Hassan est originaire, entretient des relations historiquement tendues avec la Tanzanie continentale.
Aux élections locales de Zanzibar, organisées le même jour que la présidentielle, le CCM du gouverneur sortant Hussein Mwinyi a remporté près de 80% des voix. Le ACT-Wazalendo, seul parti d'opposition autorisé à participer au scrutin à Zanzibar, a immédiatement dénoncé une "fraude massive".
Des responsables du parti ont accusé les autorités d'avoir bourré les urnes, permis à des électeurs de voter plusieurs fois sans pièce d'identité, et expulsé leurs observateurs électoraux des bureaux de dépouillement. Ces accusations, impossibles à vérifier dans le contexte de verrouillage informationnel, illustrent la faillite générale du processus électoral tanzanien.
IV. L'angle mort : une catastrophe invisible
Le silence médiatique international
Voici le paradoxe le plus troublant de cette crise : entre 100 et 700 personnes auraient été tuées en trois jours lors de manifestations post-électorales dans un pays de 68 millions d'habitants, et pourtant cette catastrophe reste largement invisible sur la scène internationale.
Comparons avec d'autres crises africaines récentes. Les manifestations au Kenya en 2024, qui ont fait plusieurs dizaines de morts, ont dominé les unes pendant des semaines. Les violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ont mobilisé l'attention mondiale. Même les crises au Soudan ou en République démocratique du Congo, pourtant chroniques, bénéficient d'une couverture médiatique régulière.
La Tanzanie, elle, disparaît. Pourquoi?
Les raisons d'une invisibilité
Plusieurs facteurs expliquent cet angle mort médiatique :
1. Le verrouillage informationnel La coupure d'Internet imposée par le gouvernement dès le 29 octobre a créé un vide documentaire. Sans images, sans vidéos, sans témoignages circulant sur les réseaux sociaux, l'histoire n'existe pas dans l'économie de l'attention contemporaine. Les rédactions internationales, déjà sous-dotées pour couvrir l'Afrique, peinent à justifier l'envoi de reporters dans un pays où l'information est impossible à collecter.
2. L'absence de relais diplomatiques La Tanzanie n'occupe pas une position stratégique majeure dans les agendas géopolitiques occidentaux ou chinois. Le pays n'est ni un grand producteur de ressources critiques, ni un théâtre de rivalité entre puissances, ni un partenaire commercial prioritaire. Cette marginalité géopolitique se traduit par une marginalité médiatique.
3. La fatigue compassionnelle L'Afrique de l'Est cumule les crises : guerre civile en Éthiopie, instabilité au Soudan du Sud, tensions au Kenya, violence récurrente en Somalie. Dans ce contexte de saturation, une nouvelle crise tanzanienne peine à émerger dans l'attention publique internationale.
4. Le vernis de respectabilité Contrairement à d'autres régimes ouvertement autoritaires, la Tanzanie de Samia Hassan maintient les apparences démocratiques. Il y a eu une élection. Il y avait des candidats (même marginaux). La présidente parle de "dialogue" et de "réconciliation". Ce vernis de normalité démocratique rend la répression moins spectaculaire, donc moins médiatisée, que dans des contextes de coup d'État ou de guerre civile ouverte.
Les réactions internationales : timides et tardives
L'ONU a réagi, mais mollement. Le secrétaire général António Guterres s'est dit "très inquiet" vendredi 31 octobre et a réclamé une "enquête minutieuse et impartiale" sur les allégations d'usage excessif de la force. Il a appelé "toutes les parties à la retenue" - une formule diplomatique qui met sur le même plan manifestants et forces de répression.
Aucune sanction n'a été évoquée. Aucun gel d'avoirs. Aucune suspension de coopération. L'Union Africaine n'a émis aucun communiqué. Les pays occidentaux sont restés largement silencieux, hormis quelques déclarations génériques sur "l'importance du respect des droits humains".
Ce silence est assourdissant. Il signale aux autorités tanzaniennes qu'elles peuvent réprimer massivement sans conséquence internationale réelle.
V. Un pays à la croisée des chemins
Samia Suluhu Hassan entame son second mandat avec un bilan paradoxal. Sur le papier, elle dispose d'une légitimité écrasante : 97,66% des voix. Dans la réalité, elle gouverne un pays profondément fracturé, où une génération entière conteste violemment le système politique actuel.
Les manifestations de fin octobre ont démontré quelque chose de fondamental : la jeunesse tanzanienne ne se satisfera plus d'une démocratie de façade. Ces jeunes qui ont affronté les balles et les gaz lacrymogènes mercredi 29 octobre ont franchi une ligne psychologique. Ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour un changement politique réel.
La question n'est plus de savoir si le régime Hassan peut tenir. C'est de savoir combien de temps il peut tenir, et à quel prix humain.
Les scénarios possibles
Scénario 1 : La normalisation autoritaire Le gouvernement parvient à écraser complètement la contestation, restaure Internet progressivement, rouvre les écoles, et impose un récit officiel minimisant les violences. La répression se poursuit de manière plus discrète. L'opposition est définitivement marginalisée. La Tanzanie rejoint le club des "démocraties illibérales" africaines où des élections ont lieu mais où l'alternance est impossible.
Scénario 2 : La pourriture lente La contestation ne disparaît pas mais devient endémique. Des manifestations sporadiques continuent, réprimées à chaque fois. Le pays s'enfonce dans une instabilité chronique qui détruit l'économie et pousse des centaines de milliers de jeunes Tanzaniens à l'exil. La Tanzanie devient un nouvel État fragile d'Afrique de l'Est.
Scénario 3 : L'explosion retardée La pression sociale continue de monter jusqu'à un point de rupture. Une nouvelle crise - économique, politique, ou les deux - fait exploser le système. Le régime CCM s'effondre, ouvrant soit une transition démocratique chaotique, soit un basculement vers un autoritarisme encore plus dur.
Aucun de ces scénarios n'est rassurant. Tous impliquent des coûts humains considérables.
Ce que cette crise révèle
Au-delà du cas tanzanien, cette élection de fin octobre 2025 révèle trois vérités inconfortables sur l'état de la démocratie en Afrique et sur l'architecture internationale des droits humains :
1. La démocratie électorale ne suffit pas Organiser une élection ne fait pas une démocratie. La Tanzanie a tenu un scrutin, compté des votes, proclamé un résultat. Mais sans liberté d'expression, sans opposition crédible, sans justice indépendante, sans médias libres, ces rituels démocratiques ne sont que des masques posés sur un système autoritaire.
2. La répression peut être massive et invisible À l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, on pourrait croire qu'une répression violente ne peut plus passer inaperçue. La Tanzanie prouve le contraire. En coupant Internet, en contrôlant les médias, en intimidant les témoins, un régime peut tuer des centaines de personnes dans un quasi-silence international.
3. L'indifférence coûte cher Le silence de la communauté internationale face aux violences tanzaniennes n'est pas neutre. Il envoie un signal à tous les régimes autoritaires d'Afrique et d'ailleurs : vous pouvez réprimer massivement si vous maintenez les apparences démocratiques et si vous n'êtes pas stratégiquement importants. Cette indifférence calcul est, à terme, une invitation à la violence.
Conclusion
Il est 18 heures à Dar es-Salaam ce samedi 1er novembre 2025. Dans la résidence présidentielle climatisée de la capitale Dodoma, Samia Suluhu Hassan vient de prêter serment pour un second mandat. Sur la télévision d'État, les images montrent une cérémonie solennelle, des applaudissements, des sourires.
À 700 kilomètres de là, dans le quartier populaire de Kariakoo, les rues sont désertes. Les chars sont toujours positionnés aux carrefours. Internet ne fonctionne toujours pas. Les familles comptent leurs absents.
Entre ces deux Tanzanies - celle des palais et celle des quartiers pauvres, celle de la victoire triomphale et celle des morts anonymes - s'ouvre un gouffre qui menace d'engloutir le pays entier.
La question n'est plus de savoir combien de personnes sont vraiment mortes le 29 octobre. Cent, cinq cents, sept cents - chaque chiffre est une tragédie. La vraie question est : comment gouverne-t-on un pays où des millions de jeunes sont prêts à mourir plutôt que d'accepter le système politique actuel?
Samia Hassan a cinq ans pour trouver une réponse. La jeunesse tanzanienne, elle, n'a déjà plus rien à perdre.


 moulaye
moulaye